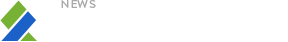La somptuaire métamorphose du mastodonte
Elle a aujourd’hui une bien grise mine cette place sur l’esplanade de l’ancien Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Le brouhaha qui accueillait ceux qui venaient de rejoindre Dakar par le ciel s’est tassé et cette clameur bigarrée qui l’accompagnait s’est estompée avec lui. Les vieux taxis déglingués qui hélaient les clients sortis de l’avion pour n’importe quelle destination dans la capitale sénégalaise ne sont plus là… Ils sont partis. Partis tous, ou presque. Comme les cambistes qui avaient pignon sur rue et les tablières et autres boutiquiers, vendeurs à la sauvette. Partis comme les tenanciers des tangana (ces fast-foods du pauvre) qui vendaient de la nourriture chaude à toute heure de la journée et de la nuit. Ils sont partis, pour certains, à «Blaise Diagne» c’est-à-dire au nouvel aéroport international éponyme de Diass situé à quelques quarante kilomètres de Dakar dans l’hinterland immédiat de la presqu’ile du Cap vert sur les collines du même nom.
« Senghor » est désormais supplanté par… « Blaise », celui qui dans leur vraie vie a été son aîné, son compatriote, son aiguillon parce que son mentor en politique. Et sous l’ombre vespérale de l’imposante statue du Monument de la renaissance (des tonnes de cuivre sur 52 mètres de hauteur), le phare de Ngor, sur l’autre « Mamelle » ; fait désormais figure de nain.


Objet emblème qui semblait veiller sur la presqu’île et irradiait ses nuits océanes pour indiquer aux navires égarés les chemins du wharf de Dakar, le phare devra , désormais, et sans doute pour longtemps encore, composer avec cette famille de géants représentée à travers la structure monumentale de bronze perchée sur la seconde colline qui formait avec la colline du phare les deux Mamelles de Dakar. C’est-à-dire cet immense objet mémoriel « force de propulsion et d’attraction dans la grandeur, la stabilité et la pérennité de l’Afrique », voulu par l’ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade et inauguré en 2010, en énormes pompes, à la face du monde ébahi, par lui et ses autres pairs africains, à l’occasion de l’ouverture officielle du Festival mondial des Arts nègres ; le second du genre, en moins de 50 ans, organisé au pays de Senghor après celui de 1966.
Le phare de Ngor devenu tout petit devant la somptuaire famille de mastodontes, que dire alors, des dômes et minarets des nombreuses mosquées alentours, face à l’envahissante immensité de ce couple de géants dont l’homme torse nu tenant son épouse par le bras, porte sur son épaule leur bébé pointant l’index vers l’horizon d’un «Ailleurs» que scrute aussi, avec eux, la fille de la famille?
Rien de vraiment nouveau et prévalent… Si ce n’est que, comme pour ces minarets des mosquées, symboles entre autres faits et indices prégnants d’une certaine présence de l’Islam et de l’adhésion de plusieurs siècles aujourd’hui de ces populations à cette religion, la nouvelle armature de cette architecture hors normes ne pourra empêcher à ces villages de Yoff, de Ngor et Ouakam (îlots de ruralité gagnés de plus en plus par une gentrification sans nom et perdus entre buildings modernes et holding de grands projets immobiliers et touristiques), de continuer à demeurer, à l’image de ces terres effilochées de la Pointe des Almadies, balayées par les alizés et poreuses aux souffles des vents venus de partout, des sanctuaires qui résistent, à la croisée des influences plurielles
Le fait religieux est partout présent dans cet antre du Dakar des origines, ricochet sans lequel on ne saurait comprendre grand-chose à l’odyssée du peuple lébou et à ses séculaires pérégrinations à travers l’espace et les âges. Ce qu’attestent fort bien, par ailleurs, les divers récits génésiaques et mythes de fondation du village de Yoff et ses deux sœurs jumelles que sont Ngor et Ouakam.
Le religieux est repérable partout; à la configuration du site et aux nombreux lieux de cultes construits qu’on y rencontre. Il se manifeste dans le quotidien des hommes, aussi bien, dans leur expérience vécue que dans les récits sur leurs origines. Il est présent dans leurs façons de gérer leurs rapports avec le monde, comme il est prégnant dans l’intimité des concessions, dans les rues, à la plage… Il est partout….

Signe patent de cette confluence de valeurs culturelles causées par la diversité des origines et du peuplement, le fait religieux s’accommode ici d’une forme de syncrétisme qui, pour le natif de cette zone passe pour la chose la plus normale au monde. Mais qui, par contre ; laisse rarement indifférent l’observateur étranger qui découvre l’endroit pour la première fois.

A l’autre bout de la même presqu’île du cap dont Ngor, Yoff et Ouakam sont les icones encore vivaces, sur les corniches qui font face à l’île de Gorée, ( Beer de sa dénomination authentique par les Lébous), Dakar continue de vivre sa mue. Sur le site de ce qui était la place de la gare qui menait vers l’embarcadère de Gorée et les mole 1 et 2 du port marchand de Dakar le décor a beaucoup changé par rapport à l’époque, déjà lointaine, où Djibril Diop Mambety, le cinéaste, auteur de « Badou Boy » et des films fétiches « hyènes » et « Le franc », y tournait, avec ses personnages, les gueux et autres figures hirsutes du Dakar-Plateau, les dernières séquences de sa « Petite vendeuse de soleil » ; dans un décorum surréaliste construit, pour l’occasion, entre les trains immobilisés depuis longtemps sur les rails envahis par la broussaille touffue des herbes sauvages rampantes et les wagons vides, livrés aux intempéries à l’usure du temps et de la rouille que venaient squatter, par moments, les marginaux du coin.
L’ancienne gare ferroviaire de Dakar fait sa cure de jouvence à la faveur du nouveau chantier du TER (le train express régional). L’édifice, un véritable joyau architectural et qui était sur le point de menacer de tomber après de longues années d’abandon, a pris un sacré coup neuf. La gare de Dakar va avoir une nouvelle vie, intégrée qu’elle sera dans l’énorme projet de création du parc culturel dénommé « Les Sept merveilles de Dakar » dont ces grandes réalisations sorties de terre et devenues réalités que sont : le Grand théâtre, le Musée des Civilisations noires, le Conservatoire de la musique etc.
Devant le square fleuri qui ouvre la gare sur le chemin du point kilométrique zéro à quelques encablures de l’ex place Protêt, la bien nommée connue pour ses « porteurs de pancartes » devenue Place de l’indépendance et la féerique Mairie de Dakar, non loin, avec son immense théâtre de verdure, Demba, l’africain et Dupont, le toubab, les deux soldats de la coloniale liés par le Destin, plastronnent fièrement, dans leur tenue de poilus. Le lieu est devenu leur ultime point de chute. Ceci, après une longue éclipse et une mystérieuse pérégrination qui aurait conduit la statue représentant ces soldats des grandes guerres mondiales des débuts du siècle dernier, de son socle sur l’ancienne place Tacher (devenue Soweto), devant l’Assemblée et le musée éponyme de l’Ifan, vers des destinations peu connues. Comme ces entrepôts supposés appartenir au Musée des armées ou quelque part dans un autre lieu non connu qui ne serait pas très éloigné du premier cimetière catholique de Dakar où ces deux frères d’armes figés dans la pierre auraient «crapahuté » avant que le monument ne regagne son emplacement actuel, dans l’environnement de ce Port de Dakar qui est pour beaucoup sur le nouveau visage qu’affiche ce Dakar en pleine transformation.

Les installations ultra-modernes de la plateforme qu’offre justement le
Le port de DakarPort autonome de Dakar rassurent sur sa métamorphose. Comme par un effet d’entrainement qui déclenche la transformation globale de l’environnement portuaire et, par ricochet, du tout Dakar, capitale du Sénégal, le PAD qui constitue un des poumons économiques est devenu une immense forêt de grues et de portiques géantes sur des étendues de conteneurs multicolores qui ont sillonné dans leur odyssée maritime nombre de mers du monde.
Du haut de la terrasse d’une de ces nombreuses tours de plusieurs dizaines d’étages du Plateau des affaires qui surplombent le port, la vue panoramique donne sur un décor aux antipodes de ce qu’était, jusqu’à récemment, le quotidien des habitués des lieux qui ont vécu la première vie du site.
Dans ce qui était plus un lieu de vie que le placide et neutre espace marchand qu’il est devenu, la machinerie moderne a supplée à la valse grouillante des foules qui se faufilaient à travers les docks encombrés entre les vieilles grues et les camions à charger sur les quais.
À l’antique, mais si charmante grisaille du wharf qu’arpentaient les marins venus des quatre coins du globe, a succédé un autre décor. Celui de quais hyper-sécurisés devenus des sortes de no-man’s land où les rares piétons habilités sont les nouveaux et seuls maitres des lieux : les rares « shift managers » et autres « Senior operators » qui assurent la supervision du travail de manutention manuelle qui n’est plus assuré par la marmaille de dockers. Mais par les quatre immenses portiques jaunes, flambant neufs qui se dressent en bord de quai sur un terminal de 600 hectares. Il faut du tact et beaucoup pour se mettre à niveau pour pouvoir se mouvoir dans le TAC (le terminal à conteneurs).
La raison de cette mue que connaît cet autre mastodonte est donnée par des experts bien au faîte des évolutions du commerce international ; experts qui ont fini de se faire leur religion sur ce que la globalisation des échanges peut représenter en relation avec les standards nouveaux et des exigences internationales incompressibles du transport multimodal ou inter-modalisme. La spécialisation obligatoire des terminaux et la démarche de dématérialisation des opérations portuaires au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication (les Ntic) : voilà, disent ces experts, les nouvelles donnes qui imposent aujourd’hui les normes en matière de management des infrastructures portuaires. Elles contraignent les ports modernes des pays émergents à des transformations du genre. Et obligent, ainsi, sa capitale, Dakar, aujourd’hui le premier port touché par les navires venant des pays du Nord (Europe, Amérique du Nord particulièrement et le dernier à la remontée), à se doter d’un port en eau profonde, disposant d’atouts naturels très importants. Et qui devrait permettre à la place de Dakar de faire valoir ses atouts forts en ce qui concerne le passage portuaire.