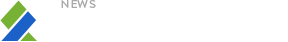Quand on nous demande de produire une réflexion philosophique sur le vivre ensemble, deux auteurs sautent à l’esprit : Aristote, qui soutenait que l’homme est essentiellement un être social, un zoon politikon et Schopenhauer, qui, dans une parabole saisissante ; la fable des –porcs épics– illustre les difficultés du vivre ensemble.
Ces auteurs intemporels ont certainement écrit des choses importantes sur le vivre ensemble. Il n’en demeure pas moins, cependant, qu’en ce qui concerne le vivre-ensemble et la coopération harmonieuse, les sociétés africaines ont produit des concepts, des réflexions et des modes de vie qui gagneraient à être diffusées et qui pourraient servir de fondement endogène à la refondation de notre vivre ensemble. Une telle réflexion sur nos concepts endogènes est d’autant plus importante et urgente que tout le monde s’accorde, à tort ou à raison, à dire que nos sociétés connaissent une certaine déréliction dont l’une des manifestations les plus effrayantes est une sorte d’ethno-nationalisme superficiel qui se dispense de penser dès lors qu’il peut prétexter que les concepts mobilisés dans l’argumentations sont étrangers ou occidentaux.
Si donc nous voulons préserver notre État de droit et les valeurs républicaines qui nous sont chères, il ne suffira pas seulement de les défendre en affirmant qu’ils sont, en droit, universelles. Il nous faudra non seulement les fonder en raison mais en plus montrer en quoi ils sont le prolongement naturel de notre civilisation. C’est dans ce cadre que s’inscrit cet article qui se propose de réfléchir sur une notion propre à la culture sénégalaise. C’est une notion qui est au moins commune à la langue pular et la langue wolof mais dont les sens en wolof sont plus riches et plus propices à une ré- flexion sur le vivre ensemble. Cette notion, c’est la notion de nawlé. Tout projet de société, tout projet politique, tout projet économique, s’appuient d’abord et avant tout sur des valeurs intériorisées par les acteurs et qui servent de toile de fond invisible mais qui déterminent toutes leurs actions. Nous nous nous proposons de montrer que pour repenser et refonder notre République qui se délite, favoriser un vivre-ensemble plus harmonieux et étouffer les germes de la division qui se minent de plus en plus notre société, nous devrions mobiliser cette notion de nawlé afin de mieux policer nos interactions et de favoriser une saine émulation qui n’empêche pas le développement mais ne tombe pas non plus dans une concurrence effrénée, dans la dé- loyauté voire dans la violence. Pour ce faire, j’aimerais que nous analysions la notion de nawlé d’abord sous l’angle de la concurrence puis sous l’angle de l’émulation et de la coopération.
Nawlé et concurrence
Le pular utilise, tout comme le wolof, le mot nawlé. Il est probable que les racines ne soient pas les mêmes et qu’il s’agisse d’un simple cas d’homophonie. Il se trouve cependant qu’il y a également une proximité de sens comme nous le verrons. Le sens de ce mot en pular est « Co- épouse ». On a également en pular le substantif « nawliraagu » qui dé- signe là situation de Co-mariage et, de manière dérivée, la concurrence entre deux personnes. En pular, donc, notre nawle est notre concurrent. Celui avec qui nous partageons une situation de mise en concurrence. Remarquons une chose qui sera intéressante dans tous les sens du concept de nawlé : c’est que cette mise en concurrence n’est pas volontaire. On ne se choisit pas sa propre co-épouse. C’est le destin, via la volonté du mari, qui nous l’impose. De même, la manière de réagir face à une situation de Co-conjugalité n’est pas totalement libre. On peut certes divorcer. Ce serait cependant perçu comme une fuite, un refus de prendre ses responsabilités, un échec. On est donc obligé d’interagir socialement avec une personne que l’on n’a pas choisie et de coconstruire avec elle, en fonction de sa personnalité, une mini-société basée, dans une mesure plus ou moins grande, sur la concurrence pour l’affection du mari. Cette situation de concurrence que le pular réserve aux co-épouses, le wolof la généralise. En wolof, notre nawlé n’est qu’accessoirement notre co-épouse. Le sens premier de nawlé en wolof n’est pas « femme avec qui on partage le même mari». En wolof, notre nawlé, c’est notre égal sur le plan social. Devant cet alter ego social, nous ne pouvons-nous permettre de paraître faible ou indigne. De ce fait, il y a également un aspect concurrentiel dans le concept de nawlé chez les wolofs. Nous devons nous montrer sous notre meilleur jour devant nos nawlés. Quelle que soit notre faiblesse réelle, nous devons serrer les dents et ne pas la montrer. Cette conception crée un style de vie dans lequel on s’épie, on essaie de se montrer à la hauteur et où le paraître prime sur l’être. Cette manière de vivre existe dans toutes les sociétés et on peut même dire que l’ultra libéralisme actuel l’exacerbe. Cette première dimension du sens de nawlé produit un « vivre-ensemble » concurrentiel. L’on se retrouve presque dans la société prônée par le libéralisme et dans laquelle chacun essaie de défendre ses propres intérêts et d’améliorer son propre sort. L’hypothèse d’Adam Smith étant que ces actions individuelles égoïstes finissaient par s’équilibrer dans une société où les vices privés produisaient des vertus publiques ; que ce soit sur le plan moral ou sur le plan économique. De la même manière, dans la société wolof, le fait que l’on soit en perpétuelle concurrence avec ses nawlés finit par produire un équilibre bénéfique dans la mesure où la société est régulée par ce besoin de paraître sous son meilleur jour que ce soit sur le plan économique ou sur le plan moral. Il est indéniable qu’une société gouvernée par cette vision concurrentielle des relations entre pairs est violente et potentiellement destructrice. Certaines explications culturalistes de la situation actuelle de notre pays peuvent s’appuyer sur le constat qu’il y a effectivement une concurrence généralisée non seulement à l’extérieur des familles mais également au sein même des fratries. L’on pourrait penser qu’une des conditions du développement est l’abandon pur et simple du concept de nawlé au profit d’un républicanisme abstrait ou d’une fraternité nationaliste voire raciale par exemple Cette lecture concurrentielle du concept de nawlé est possible et n’est certainement pas fausse. L’on peut cependant montrer qu’elle est superficielle et appauvrit voire pervertit un concept qui est essentiellement moral. Plutôt que la concurrence, le concept de nawlé vise à favoriser l’émulation.
Nawlé et émulation
« Le mot nawlé vient d’une racine, « naw » qui peut signifier soit l’admiration, soit le fort intérieur. Mon nawlé, donc, c’est non seulement mon alter ego avec lequel je suis en concurrence, mais surtout celui avec qui je devrais entretenir des relations d’admiration réciproque. »
Mouhamadou El Hady BA
Il y a une différence de connotation, plus que de sens véritablement, entre la concurrence et l’émulation. On parle d’émulation quand il s’agit de concurrence dans l’accomplissement d’une tâche jugée positive. C’est un moyen pour un groupe humain d’inviter les uns et les autres à se surpasser dans l’accomplissement du bien commun. George Sand le résumait assez bien quand elle écrivait : « Quant à moi, j’approuve le principe de l’émulation, mais à condition que la gloire des uns n’appauvrira pas les autres » Les notions de gloire et d’admiration sont essentielles dans la compréhension de la notion de nawlé chez les wolofs. Le mot nawlé vient d’une racine, « naw » qui peut signifier soit l’admiration, soit le for intérieur. Mon nawlé, donc, c’est non seulement mon alter ego avec lequel je suis en concurrence, mais surtout celui avec qui je devrais entretenir des relations d’admiration réciproque. Cette réciprocité dans l’admiration est assez peu commune. Dans la langue et la culture française, par exemple, il y a une certaine asymétrie dans la notion d’admiration. C’est là un résidu de la société de cour qu’était la France, société dans laquelle l’on admire ceux qui sont plus élevés que nous dans la hiérarchie tout en étant l’objet de leur mépris ou de leur indifférence ; au mieux de leur condescendance. Il n’en est pas de même dans la société wolof et en ce sens, elle est fondamentalement égalitaire. En effet, la relation entre nawlés est symétrique : je dois me faire admirer de mon nawlé par ma contribution positive à la société tout comme il doit se faire admirer de moi en rivalisant d’ardeur dans le bien. Contrairement à ce qui se passe dans la civilisation européenne, elle est également active. L’on se souvient que Pascal, dans les Pensées distinguait grandeur d’établissement et grandeur naturelle. Aux grands par établissement, on devait le respect pour la simple raison que la société en a décidé ainsi. Aux grands de nature, l’on doit du respect parce qu’ils sont naturellement respectables. La relation qui existe entre nawlé est plus active et est à mi-chemin entre l’établissement et la nature. L’on n’est pas nawlés uniquement parce que la société en a arbitrairement décidé ainsi. L’on ne l’est pas non plus, de manière ontologique, sans effort, par un don de la providence. Les enfants sont très tôt éduqués pour ne pas démériter face à leur nawlés. Pour rechercher le respect et l’admiration de ces derniers. Cette admiration et ce respect passent non seulement par les prouesses individuelles mais également et peut-être surtout par le sens du partage, la générosité mais aussi le fouleu i.e. la capacité à poser des limites et à les faire respecter. Une société des nawlés est une société où on respecte ses alter ego, où on essaie de les surpasser dans le bien sans les écraser, d’où l’importance du soutoura. Le soutoura étant une sorte de pudeur qui fait qu’on va essayer de protéger les autres en jetant un voile pudique sur leurs manquements. C’est une société de la générosité envers ses alter ego mais c’est également une société où la générosité ne doit pas être excessive au risque de tomber dans le niakk fouleu, l’absence de fouleu. Une bonne compréhension et une promotion de cette notion de nawlé permettrait de résoudre beaucoup de problèmes qui se posent actuellement dans notre société. Face à la déréliction de notre société, aux insultes que nous voyons proliférer dans l’espace public, à la délinquance ouverte des élites, à la généralisation d’actes traduisant de plus en plus une indifférence face au jugement moral et à la considération des pairs, il est urgent de promouvoir un retour à une société des nawlés dans laquelle l’on ne se réalise qu’en suscitant l’admiration d’autrui par l’exemplarité de son comportement.
Théoriser et promouvoir des concepts endogènes comme celui de nawlé nous permettrait de construire sur des bases plus solides notre vivre ensemble en en appelant à ce qu’il y a de meilleur dans notre culture. Étant donné par ailleurs que ces concepts sont endogènes, il va être plus facile de susciter l’adhésion autour d’eux que si les mêmes valeurs avaient été fondées et justifiées en s’appuyant sur la philosophie occidentale, par exemple.
Une dernière question se pose : cette société des nawlés n’est-elle pas une société fortement hiérarchisée ? Ne risque-t-on pas, essayant de faire de l’ingénierie sociale, de réactiver des féodalités que la République avait tant bien que mal réussi à faire disparaitre ? C’est là un problème sérieux. La société wolof, tout comme beaucoup de sociétés traditionnelles était fortement hiérarchisée. Comment éviter que la revivification des valeurs endogènes ne débouche sur une réification des inégalités aussi délétère que ce que l’on a vu à l’œuvre au Rwanda en 1994 ? Dans ce qui suit, nous allons montrer que nos sociétés, malgré cette stricte hiérarchisation apparente, ont en elles les instruments qui permettraient de développer une véritable méritocratie basée non pas sur la naissance mais sur la valeur des actes posés dans l’espace public. Certes, cette société est fortement hiérarchisée mais ce concept de nawlé est important pour comprendre comment fonctionne la hiérarchie dans la société wolof mais également dans les sociétés africaines traditionnelles. L’on verra que c’est assez différent de ce qu’il en est dans d’autres sociétés où la hiérarchie est réifiée.
Nawlé et hiérarchie
La société wolof est indéniablement hiérarchisée. D’ailleurs la notion de nawlé même reflète cette hiérarchie. Dès l’enfance, on éduque le petit wolof en lui désignant qui il doit émuler et qu’il ne doit surtout pas émuler. Il n’est pas attendu des uns ce qui est attendu des autres et une attitude acceptable des uns ne l’est pas nécessairement pour tous. L’on pourrait donc croire cette hiérarchisation d’autant plus violente qu’elle semble déterminer le destin des uns et des autres dès la naissance. C’est là un des problèmes que nous devons aborder de front si nous voulons mobiliser les concepts tirés de notre culture pour promouvoir un vivre ensemble harmonieux. Les sociétés traditionnelles africaines étaient souvent aristocratiques. Une lecture essentialiste des concepts qui les structurent pourrait justifier et perpétuer des situations oppressives. L’on peut malgré tout subvertir de l’intérieur ces situations d’oppression inacceptables tout en conservant et en élargissant notre socle de valeurs positives. Nous avons vu que la société gagnerait à promouvoir une réorganisation centrée sur le concept de nawlé, nous allons à présent voir comment le faire en subvertissant par la même occasion les réifications oppressives. Cela ne pourrait fonctionner que si cette subversion s’appuie sur l’économie des valeurs endogène. Fort heureusement, cette économie des valeurs admet plusieurs équilibres, certains plus souhaitables que d’autres. À titre d’illustration, explorons la manière dont le concept de nawlé fonctionne en rapport avec la structure familiale wolof qui est indéniablement hiérarchisée. Dans ce type de famille, le père n’est pas un membre parmi d’autres de la structure familiale, il en est véritablement chef incontesté. Ni son épouse ni ses enfants ne sont ses alter ego ; ce sont des individus placés sous sa responsabilité et sous son autorité. Malgré tout, tout wolofophone reconnaitra et comprendra les proverbes : « Diabar nawlé la » (Une épouse est un nawlé) ou « Dom nawlé la. » (Un enfant est un nawlé.) Ce faisant, la société signale à l’individu responsable du sort de ceux qu’on pourrait superficiellement voir comme ses subordonnés voire l’objet de sa tyrannie que si les individus placés sous son autorité ne sont certes pas ses égaux, il ne saurait cependant se montrer indifférents à l’opinion qu’ils peuvent avoir de lui ou se montrer indigne de leur estime. L’on est loin du modèle aristocratique dans lequel les Grands se dispensent de l’avis et du sentiment des petites gens. Dans la société wolof, contrairement aux apparences, le mari, le père ou le supérieur hiérarchique, n’est pas seulement quelqu’un qui dirige de manière discrétionnaire voire arbitraire. C’est aussi quelqu’un qui tire sa légitimité du fait qu’il se comporte comme s’il était notre alter ego et devait se faire admirer de nous, se montrer digne non seulement de notre obéissance mais également de notre estime. C’est cette recherche de l’estime réciproque qui fonde toutes les relations interindividuelles dans la société wolof elle pourrait servir de fondement à notre vivre ensemble. De fait, si le supérieur doit se faire respecter et estimer par son subordonné, c’est la fin de l’arbitraire. De plus, si l’on démocratise cette vision selon laquelle chacun est le nawlé de tous, on met fin aux stratifications sociales qui ont réifié d’obsolètes divisions du travail propre à une société préindustrielles basée sur la technique. Dans la République des nawlés, il n’y a plus ni nobles, ni serfs, ni artisans. Il n’y a que des citoyens qui sont des nawlés et qui doivent conquérir l’estime réciproque les uns des autres. L’on a là le moyen de développer non pas seulement une démocratie mais une démocratie des nawlés dans laquelle les dirigeants s’obligent non seulement à respecter les lois mais également à se regarder avec les yeux de ceux qu’ils dirigent et à se comporter selon les standards éthiques les plus élevés. Le concept de nawlé, étant au carrefour d’une série d’autres concepts éthiques comme le Diomm, le Ngor, le Foula et le Fayda permet de susciter ce que nos concitoyens ont de meilleur, d’organiser une saine émulation qui ne dégénère pas en guerre de chacun contre tous. Une refondation de notre République passera nécessairement par le réinvestissement de nos concepts endogènes au profit d’un projet politique, économique et social. C’est ce à quoi cet article a modestement essayé de contribuer.
Plus d’articles sur La Revue de Dakar