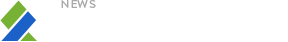La perception d’une vulnérabilité de l’Occident semble imprégner les imaginaires, plus que ne l’ont fait ces récits tragiques d’enfants, d’hommes et de femmes noyés sur les côtes de la Méditerranée et de l’Atlantique. Plus que la dangerosité du parcours, c’est la vanité de la destination qui fait réfléchir la jeunesse du continent. C’est ce que Achille Mbembé appelle “se purger du désir d’Europe”.
Parallèlement, il y a un désir d’Afrique de la part des enfants de la diaspora africaine. Une jeunesse formée et entreprenante rêve de pouvoir investir sur leur continent d’origine. Longtemps, nous avons discuté du brain drain, cette fuite des cerveaux si préjudiciable au continent. Aujourd’hui, on imagine un brain gain, un retour de ces cerveaux. Ces jeunes sont de la génération des digital natives. Nés dans la culture numérique, ils savent que le retour au pays ne prend pas forcément la forme qu’imaginait Marcus Garvey – celui d’un retour physique.

professeur agrégé et docteur en histoire, enseigne à CY Paris Cergy Université. Après sa thèse consacrée aux relations ÉtatsUnis-Afrique, il consacre une partie
de ses recherches au diasporic studies. Homme de médias, il présente pour la chaîne Télésud l’émission Diaspora.

Les réseaux sociaux, les applications mobiles qui fournissent un système de messagerie instantanée permettent un lien continu avec les parents et les amis. Enfin, la force des médias mondialisés participent de la prise de conscience d’une “famille noire mondiale”, terme utilisé sur le site de Black Lives Matter. Après l’assassinat de George Floyd par un policier blanc, des manifestations ont lieu à New York, Londres, Paris ou Lagos. Elles témoignent d’une solidarité afro-mondialisée.
Beaucoup espèrent que ces diasporas puissent jouer un rôle dans le repositionnement géopolitique du continent. Le parallèle est parfois fait avec le modèle chinois. Sur le plan de la technologie informatique, l’Inde également a su créer les conditions d’un retour des cerveaux favorisant l’émergence du pays. Aujourd’hui, 19 des 20 premières entreprises de logiciels en Inde ont des Indiens non-résidents à des postes de responsabilités. La National Association of Software and Service Companies ou le Indus Entrepreneur sont des organisations créées par des Indiens de la diaspora qui ont fait du pays l’un des premiers dans le secteur informatique.

Le terme de “diaspora” au sujet de l’Afrique s’entend d’une double manière. Il s’applique en premier lieu aux afro-descendants brésiliens, colombiens, caribéens, nord-américains dont les aïeux ont été déportés il y a des siècles lors de la traite transatlantique. Mais il s’applique aussi aux Africains et à leurs familles ayant volontairement migré au cours du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle.
L’usage de ce terme, dans le premier cas, fait débat au sein des populations concernées. Certains assument et revendiquent l’ascendance africaine. Les députés noirs aux états-Unis ont même créé un Black Caucus qui entend peser sur les orientations diplomatiques du pays en faveur de l’Afrique, comme ce fût le cas lors de la lutte contre l’apartheid. D’autres se détachent de cette ascendance africaine et insistent sur l’hybridation et la créolisation dont ils sont issus, ainsi que sur l’importance des aïeux esclaves. « Don’t call Me African American”, proclament certains Noirs américains.
29,3 millions d’Africains vivent
à l’étranger. Parmi eux, 70 %
ne sont ni en Europe ni en
Amérique du Nord, mais bien
dans un autre pays d’Afrique
Les rapports à l’Afrique des citoyens issus directement de la migration africaine sont eux-aussi complexes. Le Ghanéen Kwame Anthony Appiah évoque un « cosmopolitisme enraciné » (rooted cosmopolitanism). Il définit l’attachement à une diversité de lieux et de patries. Il prend l’exemple de son père, Joe Appiah, qui était tout à la fois nationaliste ghanéen et internationaliste. Achille Mbembe et Taiye Selasi évoquent quant à eux un « afropolitanisme », insistant sur la présence africaine dans toutes les métropoles du monde. Dubaï, Istanbul, Shanghai rejoignent aujourd’hui New York, Londres ou Paris comme destination de cette migration. L’afropolitanisme se distingue de la négritude en ce qu’il ne procède pas de la conscience d’une différence mais de la perception du commun avec le monde, ce qui fait des Africains des citoyens du village global.
Comment permettre aujourd’hui que ces diasporas contribuent à l’émergence du continent ? Plus que de dispositifs institutionnels d’accompagnement des projets (dont certains existent déjà), c’est d’un changement de mentalités qu’il faut attendre les progrès. Les outils administratifs d’accompagnement sont voués à l’échec s’ils ne sont pas humainement portés par la bonne volonté des acteurs de cette administration.
Première condition
Défrontiériser la diaspora africaine
D’après l’Union africaine, la diaspora désigne « les personnes d’origine africaine vivant hors du continent africain ». Il faut rompre avec cette africanité compartimentée, pour réintégrer le migrant africain en Afrique au cœur de la réflexion. Un migrant sénégalais qui réussit au Maroc a-t-il moins de valeur et moins à apporter à son pays d’origine qu’un Sénégalais immigré en France ou en Italie ? 29,3 millions d’Africains vivent à l’étranger. Parmi eux, 70 % ne sont ni en Europe ni en Amérique du Nord, mais bien dans un autre pays d’Afrique. Si le premier pays d’accueil des kino-congolais hors du continent est la France, cette dernière n’arrive qu’au septième rang globalement (derrière la République du Congo, l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud, l’Afrique du Sud). Donner de l’attention à ces migrants, c’est prendre conscience des ressources humaines internes au continent. Leur faciliter la vie, en termes de libre circulation et d’accompagnement de leur projet, c’est faire émerger une créativité née de la rupture avec les frontières postcoloniales. Le temps passé au poste-frontière pour franchir le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa est le symbole du temps d’avant.
Deuxième condition
comprendre que chaque enfant de la diaspora est un « entrepreneur social »
Pour accompagner au mieux les projets des Africains de la diaspora, il faut en comprendre la singularité. Il relève d’une double motivation, à la fois issue du désir de réussir et du désir d’entraide : ils veulent « générer des profits » et « faire le bien ». Les figures de l’entrepreneur et de l’humanitaire, de l’homo œconomicus et de l’homo donator, cohabitent au sein des enfants de la diaspora. Déçus par les horizons politiques et idéologiques, ils croient aux vertus de l’entreprise. Ils n’en perdent pas pour autant le salut du continent. Cette prise de conscience induit des changements de politiques publiques. Comprenant que chaque projet des enfants de la diaspora concerne l’investissement productif et le développement social, il devrait être coaché par un parrain local, professionnel dans le champ d’action concerné. Ce parrainage faciliterait toutes les étapes du processus : élaboration d’un business plan incluant les réalités du terrain, contact avec les banques locales, réduction du coût des transactions, facilitation du micro-crédit, accès à des fonds de garantie.
Troisième condition
réaliser le potentiel en matière de formation de la jeunesse
La formation de la jeunesse est le principal défi des sociétés africaines. La diaspora est le plus gros pourvoyeur de formateurs que l’on puisse imaginer. Les migrations des professeurs, des scientifiques, des chercheurs doivent faire l’objet d’une attention particulière. Des compétences multiples existent à travers le monde et doivent être mobilisées au service des élèves et des étudiants du continent. Il faut en premier lieu entreprendre une identification de ces compétences en matière de formation dans tous les domaines. L’idée pourrait déboucher sur la création d’une « université Afrique-Monde », avec une hybridation digitale et présentielle. Elle serait la première université pensée à l’échelle du monde et du continent. Cette université disposerait d’un pôle de recherche dans chaque métropole du continent et dans les grandes métropoles du monde, participant de l’influence mondiale de l’Afrique sur le plan scientifique : les mathématiques à Pretoria, la biotechnologie au Caire, l’agronomie à Lagos ou à Dakar, les sciences humaines à New York…
C’est au prix de cette mutation des représentations que le mot « diaspora » répondra à sa promesse étymologique : le grec speira signifie « semer ». Pour semer l’Afrique d’après, le rêve d’Afrique des enfants de la diaspora est essentiel. Une société ne vit pas de diagnostic, encore moins de constat désabusé. Elle se nourrit de projection vers un avenir meilleur. C’était le cas dans les années 1960, avec l’espoir des indépendances et le rêve d’un état fédéral panafricain. Aujourd’hui, invoquer une africanité forte et ouverte, par-delà les frontières nationales, permettrait de recréer un imaginaire propre à mobiliser les jeunesses du continent. Célébrer la famille africaine mondiale, c’est mettre en avant ses valeurs de solidarité humaine et de respect des équilibres planétaires, valeurs qui ont fait défaut aux civilisations qui ont bâti le monde tel qu’il est.